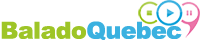Les larmes les plus douloureuses sont celles que l’on ne pleure pas (Épisode bonus)
Il y a des matins où l'on se réveille avec cette lourdeur inexplicable dans la poitrine. Comme si, pendant la nuit, le corps avait décidé de trahir les consignes de tenue impeccable que l'esprit lui dictait.
J'ai longtemps cru que la résilience était une ligne droite, un muscle qu’on entraîne. Mais elle ressemble davantage à une vague. Elle se retire, elle revient, elle nous échappe, elle nous submerge.
Ce matin-là, j’étais éreintée après avoir tenu et organisé un événement majeur. J’étais accablée par l'état du monde. Mon système nerveux s’est rebellé . Dans les bras de mon amoureux, loin des regards, des attentes et des responsabilités, les larmes sont venues. Chaudes, silencieuses. Comme une pluie d'été sur une terre craquelée.
Et là, une évidence troublante s’est imposée : je pleure souvent, mais rarement pour moi. Je pleure devant la fragilité d’un client qui ose se dévoiler en séance. Devant la beauté de l’humain, dans ses passages de vie. Devant les récits réels ou fictifs qui m’habitent.
Mais mes propres larmes, celles qui portent mes histoires, mes deuils, mes secousses intérieures, mes inquiétudes — je les garde. Comme des trésors interdits, soigneusement dissimulés.
Pourquoi est-il parfois plus facile d'accueillir la vulnérabilité des autres que la nôtre? Peut-être parce que pleurer, c'est reconnaître que quelque chose nous dépasse? Ou bien, est-ce admettre que nous ne sommes pas ces forteresses inébranlables que nous prétendons être ? Et pour celles et ceux qui portent l’armure du leader, du parent, du pilier… cet aveu ressemble-t-il à une défaite ? Ou peut-être est-ce une stratégie de diversion : poser les yeux sur l’autre pour éviter de croiser son propre reflet ?
Je me souviens de cette dirigeante qui m’a confié un jour : "Je n’ai pas versé une larme pendant trois ans, même lorsque ma mère est décédée. Et puis, un jour, c’est la facture d’électricité qui m’a fait fondre en sanglots."
Les émotions refoulées trouvent toujours une fissure. Et souvent, au moment le plus incongru.
Certains peuples considèrent les larmes comme sacrées. Versées sur la terre, elles sont une offrande aux dieux. Un nettoyage de l’âme. Nos larmes contemporaines, elles, sont rarement vues comme des dons. Plutôt comme des faiblesses à dissimuler, à sécher vite, à oublier.
Pourtant, que se passe-t-il quand nous acceptons cette vulnérabilité, cette humanité essentielle? Avant mes pleurs, j'étais agitée, irritable, étrangement déconnectée. Après, une douce clarté s'est installée. Comme si un voile s'était levé, me permettant de voir le monde et ma place en lui avec plus de justesse.
La vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force – elle en est peut-être la condition préalable.
Nous avons peur, parfois, d’être submergés par nos émotions. Comme si, une fois les larmes commencées, elles ne s’arrêteraient jamais. Mais cette peur nous fige. Elle nous durcit. Et ce durcissement nous fragilise.
Car les larmes que nous n’avons pas le courage de pleurer ne disparaissent pas. Elles se métamorphosent. En tensions. En irritabilité. En silences. En insomnies. Elles deviennent ces douleurs fantômes qui nous visitent sans prévenir.
Au fond, nos larmes ne racontent pas notre faiblesse. Elles témoignent de notre profondeur. De notre capacité à ressentir pleinement la beauté tragique — et sublime — de l’existence.
Peut-être que la véritable force, ce n’est pas de rester stoïque face aux tempêtes, mais de se laisser traverser par elles. Entièrement.
Et si, face à ces tristesses qui nous dérangent ou nous procurent de l’inconfort, l’art d’être humain consistait à ouvrir les bras et le cœur ? À s'offrir cet espace rare où les émotions n’ont pas besoin d’être justifiées. Juste autorisées. (Même sur nos lieux de travail...)
Les larmes les plus douloureuses sont celles que l’on ne pleure pas.Alors je nous souhaite cela.
De pouvoir pleurer le monde. De pouvoir pleurer nos larmes.
Qu’elles ne restent pas prisonnières de notre cœur et de notre âme.
J'ai longtemps cru que la résilience était une ligne droite, un muscle qu’on entraîne. Mais elle ressemble davantage à une vague. Elle se retire, elle revient, elle nous échappe, elle nous submerge.
Ce matin-là, j’étais éreintée après avoir tenu et organisé un événement majeur. J’étais accablée par l'état du monde. Mon système nerveux s’est rebellé . Dans les bras de mon amoureux, loin des regards, des attentes et des responsabilités, les larmes sont venues. Chaudes, silencieuses. Comme une pluie d'été sur une terre craquelée.
Et là, une évidence troublante s’est imposée : je pleure souvent, mais rarement pour moi. Je pleure devant la fragilité d’un client qui ose se dévoiler en séance. Devant la beauté de l’humain, dans ses passages de vie. Devant les récits réels ou fictifs qui m’habitent.
Mais mes propres larmes, celles qui portent mes histoires, mes deuils, mes secousses intérieures, mes inquiétudes — je les garde. Comme des trésors interdits, soigneusement dissimulés.
Pourquoi est-il parfois plus facile d'accueillir la vulnérabilité des autres que la nôtre? Peut-être parce que pleurer, c'est reconnaître que quelque chose nous dépasse? Ou bien, est-ce admettre que nous ne sommes pas ces forteresses inébranlables que nous prétendons être ? Et pour celles et ceux qui portent l’armure du leader, du parent, du pilier… cet aveu ressemble-t-il à une défaite ? Ou peut-être est-ce une stratégie de diversion : poser les yeux sur l’autre pour éviter de croiser son propre reflet ?
Je me souviens de cette dirigeante qui m’a confié un jour : "Je n’ai pas versé une larme pendant trois ans, même lorsque ma mère est décédée. Et puis, un jour, c’est la facture d’électricité qui m’a fait fondre en sanglots."
Les émotions refoulées trouvent toujours une fissure. Et souvent, au moment le plus incongru.
Certains peuples considèrent les larmes comme sacrées. Versées sur la terre, elles sont une offrande aux dieux. Un nettoyage de l’âme. Nos larmes contemporaines, elles, sont rarement vues comme des dons. Plutôt comme des faiblesses à dissimuler, à sécher vite, à oublier.
Pourtant, que se passe-t-il quand nous acceptons cette vulnérabilité, cette humanité essentielle? Avant mes pleurs, j'étais agitée, irritable, étrangement déconnectée. Après, une douce clarté s'est installée. Comme si un voile s'était levé, me permettant de voir le monde et ma place en lui avec plus de justesse.
La vulnérabilité n'est pas l'opposé de la force – elle en est peut-être la condition préalable.
Nous avons peur, parfois, d’être submergés par nos émotions. Comme si, une fois les larmes commencées, elles ne s’arrêteraient jamais. Mais cette peur nous fige. Elle nous durcit. Et ce durcissement nous fragilise.
Car les larmes que nous n’avons pas le courage de pleurer ne disparaissent pas. Elles se métamorphosent. En tensions. En irritabilité. En silences. En insomnies. Elles deviennent ces douleurs fantômes qui nous visitent sans prévenir.
Au fond, nos larmes ne racontent pas notre faiblesse. Elles témoignent de notre profondeur. De notre capacité à ressentir pleinement la beauté tragique — et sublime — de l’existence.
Peut-être que la véritable force, ce n’est pas de rester stoïque face aux tempêtes, mais de se laisser traverser par elles. Entièrement.
Et si, face à ces tristesses qui nous dérangent ou nous procurent de l’inconfort, l’art d’être humain consistait à ouvrir les bras et le cœur ? À s'offrir cet espace rare où les émotions n’ont pas besoin d’être justifiées. Juste autorisées. (Même sur nos lieux de travail...)
Les larmes les plus douloureuses sont celles que l’on ne pleure pas.Alors je nous souhaite cela.
De pouvoir pleurer le monde. De pouvoir pleurer nos larmes.
Qu’elles ne restent pas prisonnières de notre cœur et de notre âme.