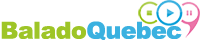Comment la chaleur affecte-t-elle notre santé mentale ?
Si les effets de la chaleur sur le corps humain sont bien connus — déshydratation, épuisement, insolation — ses répercussions sur la santé mentale le sont beaucoup moins. Pourtant, plusieurs études scientifiques, dont une très récente publiée en avril 2025 dans Nature Climate Change par une équipe de l’Université de Sydney, confirment que le réchauffement climatique ne menace pas uniquement notre environnement, mais aussi notre équilibre psychique.
Cette étude australienne a analysé les données de plus de 2 millions de personnes sur une période de 15 ans, croisant les épisodes de fortes chaleurs avec les statistiques hospitalières liées aux troubles mentaux. Résultat : à chaque hausse anormale de la température, les admissions pour crises d’angoisse, troubles de l’humeur, insomnies sévères ou épisodes psychotiques augmentent significativement — jusqu’à 14 % dans certaines régions exposées aux canicules prolongées.Comment expliquer ce phénomène ? D’abord, la chaleur perturbe notre sommeil, ce qui joue un rôle central dans la stabilité émotionnelle. L’élévation de la température corporelle empêche l’endormissement et rend les nuits fragmentées. Or, le manque de sommeil favorise l’irritabilité, les troubles anxieux et les troubles dépressifs.
Ensuite, la chaleur affecte directement le fonctionnement du cerveau. L’hypothalamus, qui régule la température corporelle, entre en tension lorsqu’il fait très chaud. Cela influence la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine, essentiels à la régulation de l’humeur. Une altération de ces substances peut aggraver des pathologies psychiatriques préexistantes ou en déclencher chez des personnes vulnérables.
Par ailleurs, les périodes de chaleur extrême sont souvent associées à une augmentation des comportements impulsifs ou violents. Une étude de 2013 par l’université de Berkeley avait déjà montré que les conflits interpersonnels (disputes, agressions, violences domestiques) augmentaient avec la température. Cette tendance pourrait s’expliquer par une baisse du seuil de tolérance au stress, combinée à l’inconfort thermique.
Le stress thermique, enfin, agit comme un facteur chronique d’anxiété. Lorsqu’il devient récurrent, il peut accentuer un sentiment de perte de contrôle ou d’insécurité, d’autant plus chez les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, précaires, malades chroniques). Ce stress est aussi alimenté par une éco-anxiété croissante, liée aux inquiétudes face au changement climatique et à ses conséquences futures.
En somme, la chaleur ne se contente pas d’échauffer nos corps : elle fragilise nos esprits. Le lien entre température et santé mentale devrait devenir une priorité de santé publique, surtout dans un monde qui se réchauffe. Prévoir des espaces climatisés accessibles, repenser l’urbanisme ou intégrer ces enjeux dans la psychiatrie sont autant de pistes cruciales pour faire face à cette menace invisible mais bien réelle. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d\'informations.
Cette étude australienne a analysé les données de plus de 2 millions de personnes sur une période de 15 ans, croisant les épisodes de fortes chaleurs avec les statistiques hospitalières liées aux troubles mentaux. Résultat : à chaque hausse anormale de la température, les admissions pour crises d’angoisse, troubles de l’humeur, insomnies sévères ou épisodes psychotiques augmentent significativement — jusqu’à 14 % dans certaines régions exposées aux canicules prolongées.Comment expliquer ce phénomène ? D’abord, la chaleur perturbe notre sommeil, ce qui joue un rôle central dans la stabilité émotionnelle. L’élévation de la température corporelle empêche l’endormissement et rend les nuits fragmentées. Or, le manque de sommeil favorise l’irritabilité, les troubles anxieux et les troubles dépressifs.
Ensuite, la chaleur affecte directement le fonctionnement du cerveau. L’hypothalamus, qui régule la température corporelle, entre en tension lorsqu’il fait très chaud. Cela influence la libération de neurotransmetteurs comme la sérotonine ou la dopamine, essentiels à la régulation de l’humeur. Une altération de ces substances peut aggraver des pathologies psychiatriques préexistantes ou en déclencher chez des personnes vulnérables.
Par ailleurs, les périodes de chaleur extrême sont souvent associées à une augmentation des comportements impulsifs ou violents. Une étude de 2013 par l’université de Berkeley avait déjà montré que les conflits interpersonnels (disputes, agressions, violences domestiques) augmentaient avec la température. Cette tendance pourrait s’expliquer par une baisse du seuil de tolérance au stress, combinée à l’inconfort thermique.
Le stress thermique, enfin, agit comme un facteur chronique d’anxiété. Lorsqu’il devient récurrent, il peut accentuer un sentiment de perte de contrôle ou d’insécurité, d’autant plus chez les personnes déjà fragilisées (personnes âgées, précaires, malades chroniques). Ce stress est aussi alimenté par une éco-anxiété croissante, liée aux inquiétudes face au changement climatique et à ses conséquences futures.
En somme, la chaleur ne se contente pas d’échauffer nos corps : elle fragilise nos esprits. Le lien entre température et santé mentale devrait devenir une priorité de santé publique, surtout dans un monde qui se réchauffe. Prévoir des espaces climatisés accessibles, repenser l’urbanisme ou intégrer ces enjeux dans la psychiatrie sont autant de pistes cruciales pour faire face à cette menace invisible mais bien réelle. Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d\'informations.